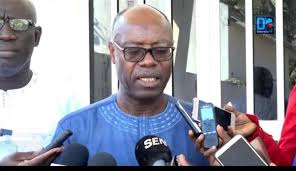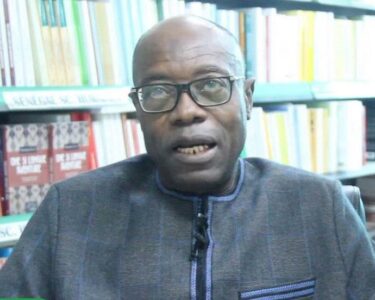Beaucoup évoquent la magnanimité de Nelson Mandela quand il s’est agi de faire payer à ses geôliers la politique d’apartheid et la condamnation et l’emprisonnement dont il avait été injustement victime.
Ce pardon, dans un contexte de vérité et réconciliation était la preuve qu’il fallait surmonter ses instincts et ses passions pour se hisser au-dessus des pulsions de l’être humain. Lequel est seul juge de sa riposte par rapport à l’affront.
Mandela a donc prouvé qu’il sait pardonner ce qu’il partage en commun sans oublier le tort qu’on lui a fait.
Au Sénégal, des hommes et des femmes se lèvent pour servir l’exemple de l’Afrique du Sud. Ils ont raison d’inviter au pardon et à la réconciliation. Raison invoquée : nous partageons le même destin.
Oui certes, nous avons une vie commune et rêvons d’un commun vouloir de la partager ensemble. Pour ce faire, nous devons savoir pardonner.
Mais pardonner est un acte individuel, personnel. Il n’exclut pas la reddition des comptes. L’amnistie est certes un bon ou mauvais arrangement mais elle ne saurait exclure un bon procès. Lequel est sensé exclure les rancœurs et les ressentiments.
Le bien commun ne peut être pardonné ni passé par perte et profit. Il est à l’image de l’impôt à la société auquel personne ne peut se soustraire. Ceux qui, jusqu’à preuve du contraire, ont des comptes à rendre, doivent le faire avant tout acte de pardon.
C’est là que la justice devient le pendant de l’équité et la condition de reconnaissance et d’assumation de la dette à la société.
C’est à partir de l’acquittement de cette dette à la collectivité que des actes de pardon et de réconciliation doivent être prononcés.
N’est-ce pas là les conditions de succès du triptyque vérité, justice, réconciliation, préludes au nécessaire pardon.
Mamadou Kassé