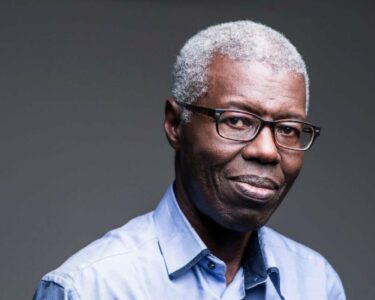Sous la présidence du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, le gouvernement sénégalais a lancé, par le biais du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur. Ce programme ambitieux vise à réorienter profondément le système universitaire, en limitant les dépenses jugées non prioritaires et en adaptant l’offre de formation aux besoins réels du pays.
Lors de la cérémonie de lancement, le président de la République a livré un chiffre révélateur : sur un investissement annuel par étudiant de 1 118 000 F CFA, seuls 483 F CFA sont destinés au volet pédagogique, le reste étant absorbé par des services sociaux. Ce déséquilibre soulève des interrogations sur l’utilisation des ressources publiques et le fonctionnement du système.
Au-delà du volet social, certaines filières sont désormais pointées du doigt pour leur faible utilité socio-économique. C’est notamment le cas de nombreux départements de langues étrangères, où des milliers d’étudiants sont orientés chaque année, sans perspectives claires d’emploi. Portugais, allemand, espagnol, russe, persan, latin, grec, langues germaniques ou slaves… la liste est longue et les débouchés rares. « Pourquoi investir des milliards pour former des étudiants qui n’occuperont, dans leur immense majorité, aucune fonction liée à ces langues ? », s’interroge une source proche du ministère.
L’idée d’une réduction drastique, voire d’une suppression pure et simple de certains départements est donc mise sur la table. Il ne s’agit pas d’interdire l’étude de ces langues, mais de rationaliser leur enseignement, en le concentrant dans des structures spécialisées comme l’Institut des Langues Étrangères Appliquées (ILEA) de l’UCAD. Quelques dizaines d’étudiants bien formés pourraient alors être dirigés vers des institutions diplomatiques, culturelles ou de coopération. Le reste des effectifs pourrait être réorienté vers des formations plus adaptées au marché du travail.
Pour les autorités, le temps du luxe universitaire est révolu. Le Sénégal ne peut plus entretenir, à grands frais, des départements consacrés à des disciplines jugées dépassées, comme le latin ou le grec ancien. « Certains affirment que ces langues aident à mieux maîtriser le français. Et après ? », lâche un universitaire favorable à la réforme.
La priorité est ailleurs : renforcer l’enseignement de l’anglais, des sciences et des technologies. Dans un monde dominé par la connaissance et la compétitivité, la maîtrise de l’anglais devient un levier essentiel pour l’insertion professionnelle et la recherche. « Pendant que nos dirigeants utilisent des casques de traduction dans toutes les rencontres internationales, d’autres pays africains intègrent pleinement l’anglais dans leur système éducatif », déplore un analyste.
Le moment est donc venu de sortir du symbolique et d’agir concrètement, en mettant fin à l’enseignement de certaines langues optionnelles au collège et au lycée, en revalorisant les filières scientifiques, et en revoyant le système d’orientation des bacheliers. Tant que certaines filières continueront d’être utilisées comme déversoirs politiques, toute réforme sera vouée à l’échec.
Après les États généraux de l’éducation de 1981 et la CNAES de 2014, l’Agenda national de transformation de l’enseignement supérieur (ANTESRI) représente peut-être la dernière chance de réformer en profondeur un système qui peine à répondre aux besoins du pays. En cas d’échec, ce serait, une fois encore, 10 à 20 années de perdues et des milliards gaspillés dans des formations sans avenir.
el faye