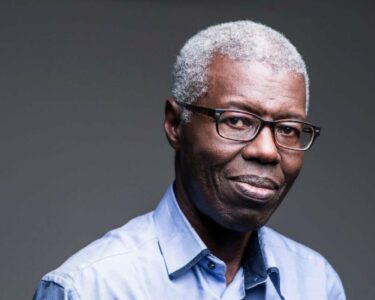L’Etat du Sénégal, par l’intermédiaire du Ministère de l’Education nationale (MEN), envisage de mettre en œuvre une réforme curriculaire concernant l’ensemble des cycles allant du primaire au secondaire. Ce projet de réforme, qui se veut inclusif, cible les programmes et les contenus à enseigner dans ces différents niveaux d’enseignement (primaire, moyen et secondaire) dans le but de les adapter aux besoins du pays et aux enjeux du monde actuel. Il est censé contrecarrer cette perception qui semble être partagée par l’ensemble des acteurs de l’éducation formelle, à savoir son extraversion et sa déconnexion des finalités sociétales et culturelles.
Pour une fois, et il convient de le saluer, les universitaires, plus particulièrement les départements de Sciences de l’éducation, sont sollicités pour apporter leur expertise sur la problématique de l’éducation. Cependant, force est de constater que l’agenda porté au pas de charge risque d’entamer la crédibilité et l’efficacité d’une réforme que tous les acteurs du sous-secteurs réclament pourtant depuis plusieurs décennies. Compte tenu de l’immensité du chantier qu’est la tâche de refonte structurelle de notre système d’éducation scolaire, sclérosé et quelque peu décalé des réalités de notre cher pays, une réforme curriculaire ne peut être envisagé dans le cadre des habituels séminaires ou en appelant à des contributions éparses de partenaires, fussent-ils universitaires, au risque d’être embourbé dans des pesanteurs corporatistes, administratives et institutionnelles. Nous proposons à nos autorités compétentes de prendre du recul et le temps nécessaire pour asseoir leurs futures décisions sur les résultats de recherches scientifiques en cours dans les départements de sciences de l’éducations de nos universités publiques.
Car une réforme curriculaire au Sénégal doit s’appuyer sur un diagnostic approfondi du système éducatif et être orienté vers deux directions. D’abord la langue d’enseignement doit être repensée : une réforme qui n’intégrerait pas la place des langues nationales (statut et fonctions) pourrait ne pas être efficace pour relier l’éducation (l’enseignement) aux finalités sociétales. C’est seulement par la suite que les programmes et contenus à enseigner, à savoir les matières scolaires, devront être revus. Nous livrons ci-dessous quelques pistes de réflexion qui sont loin d’être exhaustives.
Langue, culture et éducation sont indissociables
Toute réforme curriculaire sérieuse dans le contexte africain en général et sénégalais en particulier doit commencer par une réévaluation critique de la langue d’enseignement en vigueur. Car il existe un lien très étroit entre langue, culture et éducation scolaire. L’anthropologie classique avait déjà argumenté le lien primordial entre langue et culture. Pour les représentant de ce courant, nier ces rapports, c’est faire courir le risque de s’exposer à un énorme contresens sur la nature même du langage et des langues particulières. A travers la langue, c’est bien la culture que l’Homme met en œuvre. Elle est loin d’être un simple outil « neutre » ou un objet extérieur ; c’est à travers elle que l’Homme se construit, qu’il se développe, qu’il affirme sa personnalité, qu’il revendique son identité sociale, politique, intellectuelle et affective.
La langue exprime naturellement et spontanément des sentiments, des émotions, des passions, des images. Même les intonations, les coupures, les respirations et les arrêts dans les usages des locuteurs sont indépendants de leur intellect ou de leurs opérations mentales : ils relèvent de
leurs attributs physiologiques et biologiques en tant qu’ils constituent de manière intrinsèque des éléments de la culture. Ainsi, pour être efficace et servir l’apprenant et sa communauté, toute opération de transmission de savoirs doit se réaliser avec l’usage exclusif des langues maternelles endogènes.
En adoptant la langue française pour enseigner et apprendre, le Sénégalais rompt par la même occasion avec sa culture. L’usage du français conduit inéluctablement à une adoption de la culture française qui l’englobe : non seulement les temps d’apprentissage s’en trouvent allongés – car plusieurs années d’apprentissage sont nécessaires pour quelqu’un dont le français n’est pas la langue maternelle – mais en même temps on se prive de toute capacité créative et de tout le potentiel d’action et d’intervention sur l’environnement pour le transformer.
L’anthropologie classique a établi des vérités qui ne sont plus à démontrer : c’est à travers la culture qu’est assuré un premier niveau de réalisation de l’Homme, à savoir la satisfaction des besoins élémentaires ou organiques qui en constitue le jeu minimum. Nos besoins nutritif, reproductif et sanitaire sont résolus dans ce cadre. Se crée ensuite un milieu secondaire ou artificiel où se réalise la création d’un niveau de vie qui dépend du niveau culturel de la communauté. Bref, la culture est avant tout un ouvrage de l’homme et constitue un moyen pour parvenir à ses fins et satisfaire ses besoins à la fois primaires et secondaires. C’est le moyen qui lui permet de vivre, de s’entourer d’un certain confort, de prospérité, de sécurité, moyen qui lui donne du pouvoir et lui permet de produire des marchandises et de créer des valeurs.
Les savoirs sociaux, premières sources des « choses à enseigner »
Les études comparatives des systèmes éducatifs à travers le monde révèlent que les plus aboutis et les plus performants, que cela soit en Europe occidentale ou Asie, sont ceux où les curricula ont été élaborés à partir des savoirs sociaux des sociétés qui les abritaient. Ces résultats confirment le fait indéniable que toute société génère des savoirs sociaux stabilisés parmi lesquels sont choisis ceux qui sont dignes d’être enseignés dans les institutions scolaires. L’historien de l’éducation Guy Vincent exprime cette orientation quand il écrit que « le curriculum est une entreprise de tri culturel » validant ainsi l’idée selon laquelle « les sociétés sélectionnent les contenus scolaires à enseigner parmi les savoirs sociaux et les pratiques sociales ». Et c’est fort de cette thèse que les sociologues du curriculum, à l’instar de Jean- Claude Forquin, postulent que « l’Ecole a fondamentalement une fonction de transmission culturelle. Il ne s’agit pas uniquement de la culture savante qui est une conception subjective et individuelle de la notion. Cette transmission englobe des représentations, valeurs et des visions du monde. Ce qui doit être transmis, à travers les mécanismes de l’éducation scolaire, c’est un patrimoine de connaissances et de compétences, d’institutions, de valeurs et de symboles constitué au fil des générations et caractéristique d’une communauté humaine particulière définie de manière plus ou moins large et plus ou moins exclusive (Forquin). L’éducation scolaire se nourrit donc de la culture entendue comme l’ensemble des traits caractéristiques de mode de vie d’un groupe, d’une communauté ou d’une société donnée, y compris les aspects les plus quotidiens, les plus triviaux ou les plus inavouables.
Aujourd’hui, au Sénégal et dans la plupart des pays africains, il y a une crise de la légitimité des« choses enseignées » chez les apprenants. Les contenus enseignés sont en effet en décalage avec les attentes des élèves. Ils ne cessent de le crier haut et fort mais leurs cris semblent pour l’heure inaudibles. Les élèves sont de plus en plus nombreux à réclamer des contenus et des programmes en rapport avec leur environnement sociétal et culturel. C’est la nature même des contenus enseignés, leur pertinence, leur consistance, leur utilité, leur intérêt, leur valeur éducative ou culturelle qui leur posent aujourd’hui problème. Les méthodes livresques, encyclopédiques dont l’unique finalité est la culture générale par la mémorisation ne font plus sens chez les élèves. Il y a un réel désenchantement scolaire au Sénégal malgré l’engouement toujours tenace pour les diplômes. Les choix éducatifs sont donc bel et bien des enjeux culturels. C’est là tout le sens du lien entre éducation scolaire et culture locale. C’est fort de ces constats scientifiques que l’Etat doit envisager sa réforme curriculaire. Celle-ci ne peut se satisfaire des séminaires de cadrage ou de production où les acteurs conviés viennent pour valider des dispositifs qui sont ficelés en amont dans les bureaux des ministères et des directions.
Pour une réforme pertinente et efficace du système scolaire au Sénégal, il convient de faire preuve de courage et d’engagement en misant sur une remise en question radicale de la langue d’enseignement en vigueur, à savoir le français. Au niveau de la recherche universitaire, la nécessité de recourir exclusivement aux langues nationales n’est plus à démonter, elle est scientifiquement démontrée et politiquement justifiée. Les centres d’intérêt de cette recherche se sont déplacés à un autre niveau, celui de la détermination de la langue nationale à choisir pour harmoniser le système dans sa globalité. C’est dire que les programmes d’enseignement bilingue qui sont en mis en œuvre comme le Renforcement de la Lecture initiale pour Tous (le RELIT) ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils mènent à la dispersion et à des fractures scolaires : un Etat doit garantir l’homogénéité scolaire et linguistique.
Ces programmes sont certes des tremplins relativement efficaces pour pallier aux problèmes de compréhension écrite des élèves dont le rapport à la langue française est de plus en plus distant au fil des générations ; ils restent des « béquilles » pour pérenniser l’enseignement et l’apprentissage en français, ce qui laissera intacts les problèmes substantiels que pose la transposition des savoirs et des savoir-faire par le truchement d’une langue étrangère. Les gains que l’on pourrait tirer du rétablissement des liens entre langue, culture et éducation scolaire seront nuls.
La finalité de la réforme curriculaire pourrait être l’enseignement des sciences en langues nationales
C’est parce que les systèmes éducatifs des pays anciennement colonisés se sont écartés des cultures et des langues endogènes que l’Afrique n’a pas été reconnue comme étant le berceau de l’ordinateur numérique. En effet l’invention de cet outil révolutionnaire a été portée par les mathématiques fractales dont les chercheurs égyptologues ont située la naissance et le développement en Afrique subsaharienne. Et cette même Afrique a laissé les Occidentaux venir puiser dans son patrimoine de savoir botanique pour développer leur industrie pharmaceutique pendant que les chercheurs africains répertoriaient plus de trois milles plantes dans le continent qui ont des propriétés médicinales.
Les questions relatives à la langue d’enseignement et à l’encastrement de l’école aux cultures locales constituent donc les axes prioritaires pour une refonte structurelle de notre système éducatif. Avec une réforme curriculaire réfléchie et mûrie, basée sur les résultats des recherches, le Sénégal doit redonner une chance aux conclusions issues des états généraux de l’éducation (EGEF) de 1981 et plus particulièrement à la planification linguistique opérée alors par la Commission nationale pour la Réforme de l’Education et de la Formation (CNREF) : partir des langues du milieu pour l’apprentissage des élèves les deux (2) premières années du cycle élémentaire et, à partir de la troisième année (CE1), utiliser exclusivement la langue d’unification (qui est le wolof) laquelle sera associée à la langue arabe jusqu’à la deuxième année du cycle moyen où les élèves apprendront d’autres langues internationales comme le français et l’anglais. L’enseignement bilingue (français/LN) mis en œuvre dans le cadre du RELIT serait ainsi supprimé pour laisser la place à un enseignement exclusif en langue nationale d’unification.
Une réforme de la langue d’enseignement constitue donc l’étape première d’une réforme des curricula. Si la vision politique qui la porte est légitime au nom de l’éthique de la responsabilité, elle nécessite néanmoins des ateliers de production et de validation regroupant des linguistes, des sociolinguistes (sociologie et anthropologie du langage), des professionnels de l’éducation (professeurs des écoles et inspecteurs de l’éducation). Le recours à la consultance étrangère, fusse-t-elle canadienne ou européenne, n’est pas opérant et risque de nous engager dans les mêmes impasses que nous avons connues avec le Programme de développement de l’Education et de la Formation (PDEF).
Par Dr Mamadou Lamine COULIBALY, Enseignant chercheur au Département des Sciences de l’Education
Université Gaston Berger de Saint-Louis