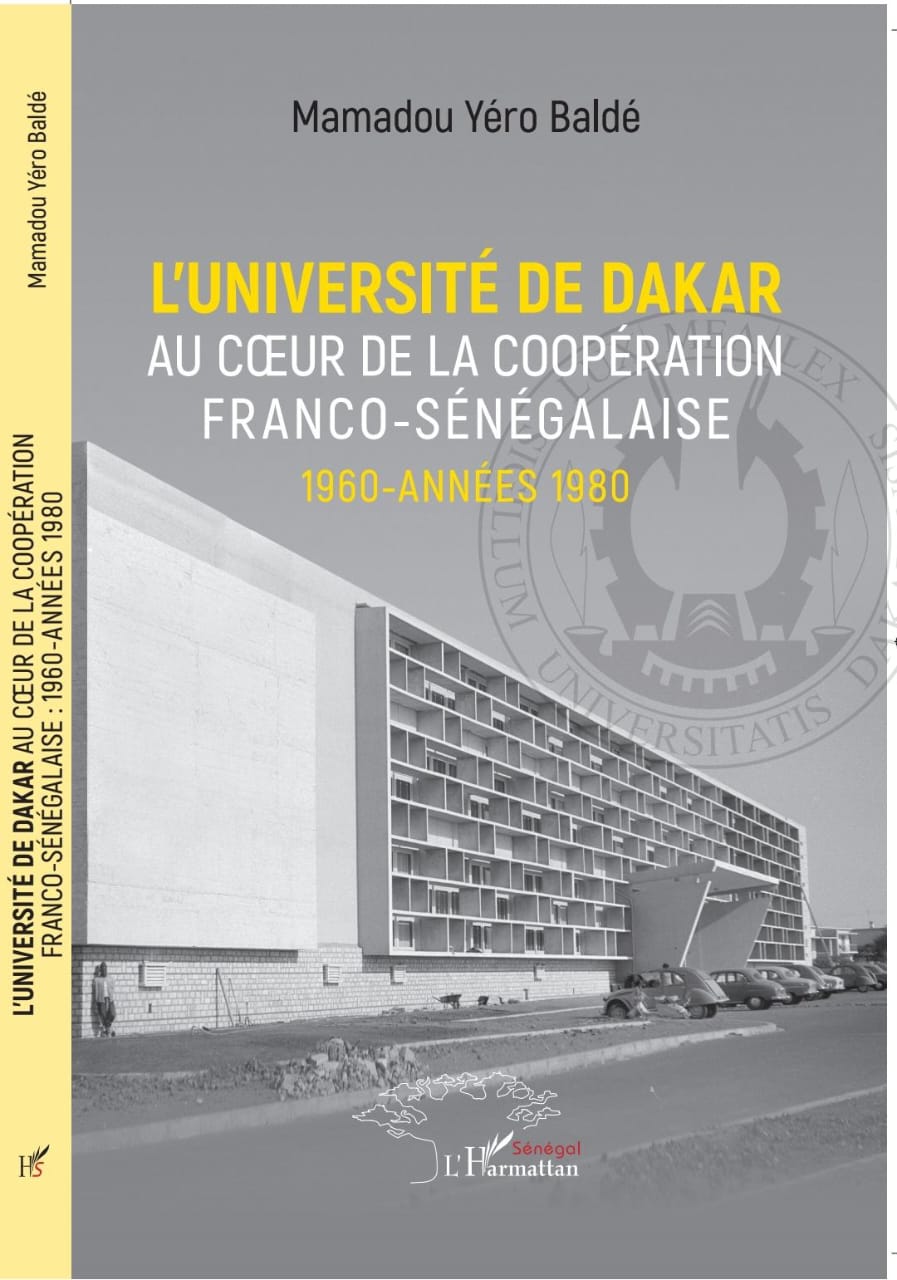Dans son essai percutant L’Université de Dakar au cœur de la coopération franco-sénégalaise : 1960 – années 1980, Mamadou Yéro Baldé explore les mécanismes d’une domination postcoloniale, subtile mais redoutablement efficace, qui s’est exercée au cœur de l’Université de Dakar.
Derrière les discours officiels sur la coopération entre la France et le Sénégal, l’auteur — historien et enseignant-chercheur à la FASTEF (Université Cheikh Anta Diop de Dakar) — dévoile un réseau sophistiqué d’influence culturelle et politique mis en place par la France dès le lendemain de l’indépendance. Plus qu’un simple livre d’histoire, c’est une enquête fouillée sur les ressorts du néocolonialisme intellectuel.
L’université, un outil stratégique
Dans le contexte tendu de la guerre froide, où les anciennes colonies deviennent des terrains de rivalité géostratégique, la France comprend rapidement qu’elle doit miser sur la diplomatie des idées, de la langue et de la culture pour maintenir son influence en Afrique. L’université devient alors un levier clé de ce soft power.L’Université de Dakar, devenue UCAD, est présentée par l’auteur comme la vitrine de cette influence française. Par le biais des coopérants — ces assistants techniques qui, sous prétexte d’aide au développement, jouent un rôle crucial dans la formation des futures élites sénégalaises —, un projet de maintien idéologique se déploie. Derrière les matières enseignées se dissimule une volonté de modeler les esprits : les étudiants sont immergés dans la culture française, imprégnés de ses références, pour assumer à terme des rôles clés dans un cadre institutionnel largement influencé par Paris.
–Une coopération ambivalente
Néanmoins, Baldé évite tout manichéisme. Son propos ne se réduit pas à une dénonciation unilatérale de la France. Le Sénégal indépendant, et ses dirigeants notamment, a su tirer parti de cette collaboration. Devant l’ampleur de la tâche consistant à bâtir un État moderne avec des ressources limitées, les autorités sénégalaises ont vu dans cette coopération une opportunité. « Construire la nation en hommes avant de la bâtir en pierre », souligne l’auteur, reprenant les mots de Léopold Sédar Senghor.Ainsi, cette coopération universitaire devient un compromis. La France préserve ses intérêts en cultivant la fidélité des élites francophones, tandis que le Sénégal en profite pour moderniser ses institutions et former ses propres cadres. Le livre met en lumière cette tension constante entre instrumentalisme et dépendance consentie.-
Les coopérants, loin d’être neutres
Un des apports majeurs de l’ouvrage est de montrer que les coopérants français n’étaient pas de simples transmetteurs de savoirs désintéressés. Nombre d’entre eux, issus de l’administration coloniale, préservent ce que l’auteur appelle « l’esprit colonial ». Leur présence massive dans des facultés stratégiques comme celles des Lettres ou du Droit en est révélatrice. Leur enseignement perpétue un modèle culturel et politique, souvent au détriment d’une pensée africaine autonome.L’auteur qualifie ces acteurs de « passeurs de culture et relais d’une domination symbolique ». Appuyé par de nombreux documents d’archives et témoignages, l’ouvrage constitue un véritable travail d’historien engagé.
Un domaine peu exploré
Le mérite de Mamadou Yéro Baldé est de combler un vide dans l’historiographie. La coopération universitaire postindépendance est rarement abordée dans les travaux académiques, souvent cantonnée aux discours ou archives diplomatiques. En s’appuyant sur des sources variées — archives, documents universitaires, anciennes publications, entretiens —, l’auteur restitue toute la complexité de ces relations faites de convergences, d’intérêts et de stratégies.