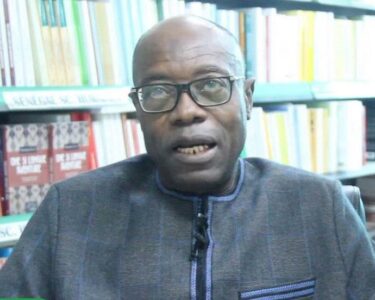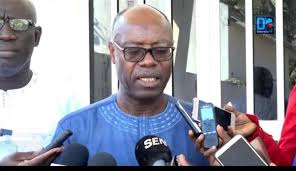Depuis janvier 2025, un mot venu d’ailleurs a pris racine dans le jardin politique et social sénégalais. Kuluna, mot importé de la République Démocratique du Congo (RDC), désigne, à l’origine, des bandes de jeunes délinquants violents. Mais au Sénégal, il a connu un glissement sémantique étonnant, devenant une métaphore politique, une insulte sociale, et parfois même un ressort humoristique. Quelles significations prend ce mot dans le contexte sénégalais ? Et que révèle-t-il de plus profond sur nos sociétés et nos liens africains ?
Origine du terme : une réalité dure et multiforme
En RDC, les Kulunas sont des jeunes souvent issus des milieux défavorisés, organisés en gangs urbains. Machettes ou couteaux à la main, ils sont tristement connus pour semer la peur à Kinshasa ou dans d’autres grandes villes. Ce phénomène s’explique par une exclusion sociale, l’absence de structures d’encadrement, et un sentiment d’abandon par l’État. Des opérations de police comme « Likofi » (2013-2014) ont tenté de les neutraliser, mais non sans excès, violations des droits humains et exécutions extrajudiciaires dénoncées par plusieurs ONG.
Au Congo-Brazzaville, le terme Kuluna existe aussi, mais il est souvent confondu avec d’autres expressions locales. Là-bas, ce sont les « bébés noirs » qui représentent cette jeunesse marginalisée et violente. En Côte d’Ivoire, ce sont les « microbes », ces jeunes agresseurs, souvent livrés à eux-mêmes, qui incarnent ce même phénomène de violence urbaine juvénile. Ainsi, à travers plusieurs pays africains, le phénomène est similaire, mais les appellations varient, soulignant des dynamiques communes de rupture sociale.
Kuluna au Sénégal : satire, politique et langage populaire
Au Sénégal, le mot Kuluna a été détourné de son sens initial criminel. Il est aujourd’hui employé dans les débats publics, notamment sur les réseaux sociaux, pour désigner des figures perçues comme brutales, extrémistes ou nuisibles dans le champ politique. Certains l’utilisent pour qualifier des partisans zélés de l’ancien régime, d’autres pour désigner ceux du pouvoir actuel. Dans tous les cas,
il s’agit d’un mot chargé, provocateur, et fortement symbolique, utilisé pour ridiculiser, dénoncer ou alerter.
Satire politique et cousinage à plaisanterie : un art sénégalais
Cet usage ironique du mot Kuluna n’est pas nouveau dans la culture sénégalaise. Il fait écho à une tradition profondément enracinée : le cousinage à plaisanterie, appelé kal en wolof, kathiolor en diola, dendiraagal en pulaar ou sanankuya en mandingue.Cette tradition permet aux membres de certaines ethnies ou familles de se moquer librement les uns des autres, parfois de manière très directe, mais toujours dans un cadre respectueux et pacifique. C’est un mécanisme de régulation sociale, de critique ritualisée, où l’humour devient un instrument de cohésion. Appeler quelqu’un « Kuluna » dans le contexte politique sénégalais relève du même mécanisme culturel : on accuse, on provoque, on ironise, mais souvent pour désamorcer ou détourner la tension. Cela démontre encore une fois la puissance du langage populaire sénégalais, capable d’absorber un mot étranger, de le transformer, et de lui donner un sens local, culturellement assumé.
Le mot Kuluna présente une double dimension, à la fois insulte politique et forme de revendication sociale. Sur le plan politique, il est devenu une arme discursive servant à discréditer un adversaire, qu’il soit issu de l’ancien régime, de l’opposition ou même du pouvoir en place. Sur le plan social, il témoigne de la créativité du langage populaire sénégalais, toujours prompt à détourner les mots pour en faire des outils de satire et de critique. Enfin, sur le plan symbolique, ce terme reflète une tension continentale plus profonde : celle d’une jeunesse africaine souvent marginalisée, diabolisée ou instrumentalisée, mais rarement écoutée, valorisée ou réellement intégrée dans les processus de décision.
Kuluna et l’imaginaire d’une Afrique en quête de sens
L’itinéraire du mot Kuluna, de Kinshasa à Dakar, dépasse le simple transfert lexical. Il révèle un véritable dialogue culturel africain, où les mots circulent, changent de sens et s’adaptent aux réalités locales. Cette mobilité linguistique spontanée témoigne d’une unité souterraine entre les peuples, une forme de compréhension mutuelle qui dépasse les frontières. Le mot Kuluna, qu’il désigne des gangs urbains, des jeunes marginalisés ou des figures politiques controversées, met en lumière des fractures sociales partagées. Partout, la jeunesse africaine cherche à s’exprimer, à se faire entendre, que ce soit dans les rues ou sur les réseaux sociaux. Le mot devient alors l’écho d’un cri commun : celui d’une génération en quête de sens et de justice.
Plutôt que de renforcer les stigmatisations, cette réappropriation du mot peut ouvrir la voie à un nouvel imaginaire panafricain. Dans les médias, la littérature ou les discours militants, Kuluna pourrait symboliser la résilience, la résistance, et l’audace de nos jeunesses. Une Afrique qui rit, qui crée, qui dénonce, mais surtout qui s’écoute et se comprend. En cela, Kuluna devient bien plus qu’un mot : il devient un miroir de nos luttes communes et un levier de transformation collective.
Conclusion
L’apparition du mot Kuluna dans le lexique politique et social sénégalais n’est pas anodine. Elle révèle notre capacité à interpréter, détourner et donner du sens, tout en montrant que nos sociétés sont connectées bien au-delà des frontières politiques. Le mot devient alors un pont : un pont entre les jeunesses africaines, souvent confrontées aux mêmes défis ; un pont entre tradition et modernité, entre le cousinage à plaisanterie et la satire numérique ; un pont entre souffrances vécues et expressions libérées. C’est peut-être dans ces mots qui voyagent et changent de peau que se cachent les premières briques de l’intégration africaine- une intégration qui ne viendra peut-être pas seulement des sommets politiques, mais bien du langage des peuples.
DIALLO AMADOU :
Co-fondateur du CIRI (Cabinet intégré des Relations internationales),
Spécialiste en relations internationales